COMPETITION NOUVEAUX TALENTS
LES
FILMS
AU DELAS DES NUAGES
MARI GULBANI
« Enfant, j’ai demandé à mon grand-père : « Qu’est-ce que la vie ? ». Il a réfléchi. « La vie, c’est la tristesse du pays natal ». « Et qu’est-ce que la mort ? ». « La mort, c’est la tristesse de ce paradis perdu ». Ces mots m’accompagnent souvent. Mon grand père était de Svanetie. J’ai suivi mes souvenirs d’enfance et je suis partie dans son pays. Est-ce que Larissa l’Ukrainienne et son rêve de vie en Svanétie, Kafjan et son rêve de mourir loin là-bas de l’autre côté du Caucase, me feront comprendre ses mots ? »
BAKOROMAN
SIMPLICE GANOU

Quitter sa famille à 7 ans, à 12 ans, à 16 ans. Partir en terrain inconnu. Elire domicile devant un magasin, dans un vidéo club, aux abords d’une gare routière. Apprendre à se droguer, à mendier, à voler, à fuir, à se battre, à ne plus avoir peur. Se faire des amis et des ennemis. Intégrer un nouveau monde. S’adapter. Ce film fait, de l’intérieur, le portrait particulier de quelques Bakoroman de Gounghin, un quartier central de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.
BELLEVUE, DERNIERE SEANCE
ABRAHAM COHEN
« Bellevue, dernière séance est l’histoire d’un lieu, d’enfants malades, de familles en souffrance, mon histoire. Bellevue, un centre pour enfant asthmatiques et obèses principalement, dans lequel j’ai + moi-même effectué plusieurs séjours. Ce lieu ne m’a jamais quitté. »
BIR D'EAU, A WALKMOVIE
DJAMIL BELOUCIF
Journée ordinaire d’une rue d’Alger où un film se fait et se défait sous le regard d’une caméra.
LE BONHEUR SIMPLE
KY NGUYEN MINH
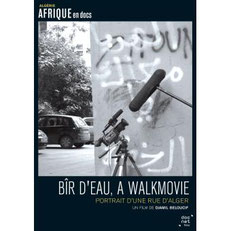
Le bonheur simple raconte l’histoire d’un couple qui laisse ses enfants à la campagne pour vivre et travailler dans un bateau sur la rivière Han de Danang (Vietnam)
LE CRABE QUI M'A PINCE L'OEIL
FRANCOISE PERBET-SAVELLI
Apprendre que l’on a un cancer est une épreuve difficile à vivre. Ce film est un essai de dédramatisation, une tentative pour « donner à voir » une vision qui se transforme avec la maladie. En vidéo et animation.
DANS L'OMBRE
BART VERMEET

La Belgique, au coeur de l’Europe, paraît pour beaucoup de réfugiés politiques comme la Terre Promise. Mais que faire lorsqu’on est submergé dans un système politique,
submergé de contradictions et d’apathie, et qu’on finit par se retrouver face à face avec l’inverse de la liberté tant souhaitée ?
EN APPARENCE
MAXIME MORICEAU

Second Life, février 2011. Superficie : 2 millions de km2. Nombre d’habitants : inconnu. Je n’y suis jamais allé, mais ça me paraît grand, immense. Ca ne ressemble à rien de ce que je connais. J’ai envie d’y entrer, de faire de nouvelles rencontres. Parler à des gens que je ne verrai peut-être jamais ailleurs. Etre moi-même, tout simplement.
FUNERAL SEASON
MATTHEW LANCIT

Dans ce qui ressemble à une histoire de fantômes, un étranger se trouve au milieu d’une culture où les morts ne sont pas vraiment morts. De village en village, à travers le Cameroun, les
habitants le conduisent à des fêtes
funéraires où règne la joie.
LE GESTE ORDINAIRE
MAXIME COTON

Portrait d’un homme discret : un ouvrier. Portrait de Marc Coton, père du réalisateur. Echos d’un mutisme chaleureux qui aura jusque là laissé sa famille loin du vacarme de l’usine sidérurgique
où il travaille depuis
trente ans.
HONK
ARNAUD GAILLARD & FLORENT VASSAULT

A travers trois portraits croisés, voyage au coeur de la peine de mort aux Etats-Unis.
IL ETAIT UNE FOIS L'ETE
SIRAKAN VAMAN ABCOYAN
Je suis de Vardenik, un village de la vallée. J’ai pris ma caméra pour accompagner ma famille qui part pour l’estive sur la montagne de Sordarivar. J’ai tourné, il y a six ans, ce film de famille. Mon oncle qui montait vaillamment sur son âne est mort. On ne va plus chercher sur le sommets le foin rempli de fleurs qui parfumait le lait. J’ai revu ces images qui gardent un peu de mon paradis d’Arménie et je vais en faire un film.
J'AI NAGE TOUTE SEULE
IRIS PAKULLA

« Je me sens mal ici. Cette maison est creuse, vide. Je me sens seule. Je veux partir d’ici. Aller quelque part d’autre, peut-être aller dans un maison de retraite. Làbas, il y a plus de monde, des rencontres, c’est plus humain. C’est fait pour ça la vie, pour faire des rencontres, aller vers l’humain. Les soeurs ont pris l’habitude d’être comme ça, seules. Je voulais vous écrire pour que vous fassiez une lettre à la Supérieure pour que je puisse partir. Pouvez-vous le faire ? Pouvez-vous m’aider ?
LA-BAS DERT ANNAA
CLAUDIA MARSCHAL

Des prairies nébuleuses, des lacs et des forêts impénétrables. Une Alsace brumeuse, 1836 habitants. De l’autre côté de l’océan, les Etats-Unis, Castroville-Texas, 2664 habitants. Un village ordinaire, traversé par une autoroute à quatre voies, bordé de champs brûlés par le soleil. Là-bas, les cow-boys parlent une langue étrange, inconnue de certains, mais essentielle pour d’autres. Des secrets sont partagés. Des liens renoués. Des souvenirs d’antan réveillés. Mais la terre n’a jamais été aussi aride : « priez pour qu’il pleuve ! ». Un miracle n’est pas exclu, mais un cow-boy devrait peut-être quitter sa terre natale pour s’aventurer de l’autre côté.
MARIE-FRANCE
BITSCHY ARNO
Depuis vingt ans, Marie-France recouvre son corps de tatouages. Une vie de galère, d’échecs et de souffrance. Marie-France est le portrait d’une autre France.
NAGER COMME SI C'ETAIT HIER
OGILVIE ISABELLE & OLIVIER DEROUSSEAU

Ce film, coréalisé, est l’évocation d’un voyage qui commence à Roubaix, passe par Paris, Grenoble, Lussas, Cerbère, jusqu’à Porbou. Le Mémorial Walter Benjamin est à Porbou. En 2003, Isabelle Ogilvie est actrice dans un film d’Olivier Derousseau, Dreyer pour mémoire. C’est dans ce contexte qu’elle transmet une irrépressible envie : « faire du cinéma ». Nous sommes en 2011, un film s’achève. Il figure l’histoire d’une rencontre et d’un malentendu. Rencontre d’un homme et d’une femme qui tentent de vérifier ce qu’égalité veut dire et malentendu à propos du destin des images.
LA NATURE DES CHOSES
AUDREY ESPINASSE

Des agneaux, du feu, des hommes : la célébration des fêtes de Pâques à travers l’élaboration d’un repas dans un monastère bénédictin.
LE PASSEUR DES AMES
COUYHN TRUONG VU
Dans un village du centre du Vietnam, un fermier est également maître de cérémonie lors de funérailles. Il chante pour accompagner l’âme des morts vers le ciel. Les gens d’ici sont nés de la terre, et lorsqu’ils meurent, ils reviennent à la terre. La mort rapproche ceux qui, pendant la guerre, n’étaient pas du même côté.
SIBERIE
JOHANNA PREISS

A bord du Transsibérien, un couple en voyage. Munis de caméras numériques, Joana (Preiss) et Bruno (Dumont) enregistrent leur complicité et leurs déchirements, traquent les faiblesses et les aveux face à un territoire froid et infini. L’occasion de mettre leur amour à l’épreuve de l’isolement, de l’étranger, du cinéma.
