THEMATIQUE // MIGRATIONS
LES FILMS
ABENA
AMEL EL KAMEL

1963
Une couverture de laine tissée par une grand-mère tunisienne. Autour de cette couverture qui a traversé la Méditerranée, au fil de ce brin de laine transmis de mère en fille, s’élève la polyphonie des sentiments d’une famille qui vit des deux côtés de la mer, qui parle deux langues. En choisissant de ne pas « figurer » les paroles mais de les laisser courir sur ce fil entre deux rives, Amel El Kamel crée une sensible tension, attention aux mots, à la texture des mots. Ce language tout simple se fait universel. Comme pour la couverture, c’est sa simplicité qui rend ce film vraiment beau.
AMERICA, AMERICA
ELIA KAZAN

1963
Il marque un tournant dans la vie et l'oeuvre de Kazan. il choisit de travailler son cinéma différemment, avec une part plus intime de lui-même. Une voix off ouvre et clôt le récit, filmé en noir et blanc et sans stars, qui est celui du voyage de son oncle, de l'Anatolie à l'Amérique. Stavros Topouzoglou, le personnage principal d'America, America, est interprété par Stathis Giallelis un acteur non-professionnel grec qui fait ici sa première apparition à l'écran. Ce récit tiré de la réalité devient ici une fable autour du voyage iniatique d’un jeune grec naïf, mais aussi une grandiose épopée portée par le rêve américain des immigrés du début du XXème siècle. (A.P.G.)
ARIVANTS (LES)
PATRICE CHAGNARD & CLAUDINE BORIES

2009
Ils viennent d’Azerbaïdjan, de Mongolie, du Congo, du Sri Lanka, d’Irak ou de Tchétchénie. Ils débarquent de partout, chaque jour, par familles entières, avec ou sans bagages, avec ou sans passeport, dans des charters ou des camions bâchés. Parmi eux il y a des femmes enceintes, des couples d’amoureux tellement jeunes qu’ils semblent être en fugue. Des vieillards a l’air digne et égaré. Ils ont le regard épuisé et fiévreux. On peut y lire à la fois une peur immense, une sorte d’hébétude et l’espoir le plus fou.
ATLANTIQUES
MATI DIOP

2009
A la nuit tombée, quelques jeunes Dakarois se retrouvent autour du feu, sur la plage. C’est là, sous le ciel noir entre la ville et l’océan, qu’ils se racontent leur désespoir d’être là et leur espoir de partir ailleurs. Dans les flammes leurs récits prennent des lueurs épiques. Tous écoutent Serigne, un d’une vingtaine d’années, qui a franchi le pas de la traversée clandestine. Et qui en est revenu, sauf mais sans avoir touché l’autre rive, celle de l’Europe rêvée. Il raconte à ses amis son odyssée tragique. Quelques temps plus tard, on les retrouve à la même place. Mais Serigne n’est plus là. Les bouteilles de bière tournent, les têtes aussi.
CAI HO (LE LAC)
CHRISTIAN MERLHIOT

2004
C’est à travers la romanisation de l’écriture de l’alphabet imposé par le Protectorat français que le film de Christian Merlhiot, Cai Ho, le lac évoque la colonisation vietnamienne. Il laisse entendre, dans un deuxième temps, la désorientation de la langue française saisie dans les différentes retranscriptions d’un poème de Lamartine, Le lac. En combinant la lecteur qui vantent les mérites de cette avec de longs travellings tournés au gré du courant lent d’un fleuve vietnamien, le cinéaste flotte sur cette réalité que les mots ne savent plus comment nommer.Dans une deuxième séquence, une actrice-traductrice maltraite le poème de Lamartine, le lac, comme en représailles de la violence faite naguère à la langue colonisée.
HACLA (LA CLOTURE)
TARIQ TEGUIA

2002
À travers le cri de ces jeunes Algérois, Haçla (la clôture) donne à voir et à entendre, dans l’horizon bas de la ville d'Alger noyée de grisaille, une société bloquée, refermée sur elle-même, où la parole tente de passer les clôtures. Il pleut sur Alger, et Tariq Teguia dessine sur les vitres mouillées d’une voiture en errance, une géographie de la colère et de l’impuissance.
DE L'AUTRE COTE
CHANTAL AKERMAN

2003
En Amérique du Nord, les Mexicains sont passés pendant des années par San Diego pour franchir la frontière, mais le Service d'Immigration américain est parvenu à stopper le flux des immigrés clandestins dans cette partie de la Californie et à le déporter vers les régions désertiques et montagneuses de l'Arizona. Là, ils ont cru que les difficultés, les dangers, le froid et la chaleur les arrêteraient... C’est avec De l’autre côté que Chantal Akerman clôt le 3ème volet de son triptyque après D’Est (1993) et Sud (1999). Elle est partie en équipe très réduite au Mexique, près de la frontière américaine, une frontière qui n'est pas simplement un trait sur une carte mais un mur et des barbelés dans le paysage... Les témoignages alternent avec de longs plans fixes des lieux. Ici commence, pour les Mexicains candidats à l’exil, une longue marche dans un désert inhospitalier. L'équipe du film passe alors de l'autre coté. Côté américain.
DEPUIS LES TERRES DE PERSONNE
ELVIO ANNESE

2009
« La Bovisa était un ancien quartier ouvrier dans la banlieue milanaise. A la fin des années 70, il a été confronté au démantèlement industriel. Ce documentaire est composé d’images que j’ai tournées personnellement au cours des années 1976, 1989, 1991, 2005, 2007 , 2008, 2009 . Le temps rapproche ces fragments de vie aux marges de la ville. En grande partie, le montage est conçu comme celui d’un film muet. Il n’y a que des visions, des images sans commentaire, afin de laisser l’espace à la poésie de la vie. »
Elvio Annese
DOR
RAMONA POENARU

2008
« Un ancien conte roumain guide un périple qui traverse une géographie émotionnelle, peuplée d’êtres déplacés, vivant une situation d’entre-deux : deux frères jumeaux séparés par mille six cents kilomètres d’un rêve d’Ouest, un jeune homme moldave subissant le calme occidental comme une pastille anesthésiante, une grand-mère vivant dans un pays dont le seul souvenir est celui d’une vieille chason, une jeune femme accomplissant un voyage comme le rituel d’un impossible retour. Entre documentaire et fiction, une variation sur la nostalgie (DOR) et le désir du retour, sans mélancolie pourtant… » Ramona Poenaru
LES DORMANTS
PIERRE-YVES VANDEWEERD

2008
Les quatre récits de ce film nous entraînent de la Belgique aux rives du fleuve Sénégal, des Ardennes françaises aux montagnes du Sahara occidental. Ils nous guident à la rencontre de dormants. Des hommes et des femmes évoluant entre deux mondes, celui des absents et celui des vivants, entre deux états, celui de l’éveil et celui du sommeil.
L'EMIGRANT
CHARLIE CHAPLIN

1917
Sur le paquebot qui les emporte vers le « Pays de la liberté », ils sont nombreux, pauvres, affamés, hagards, qui viennent d’une Europe alors en pleine « Première guerre mondiale ». Tous les personnages de l’univers de Chaplin sont là : une belle jeune fille blonde (Edna Purviance) et sa mère malade, un grand gaillard acerbe et moustachu pris du mal de mer, quelques vauriens qui jouent aux cartes… Et Charlot le vagabond. Au rythme du tangage du bateau se succèdent les sketches burlesques qui n’entament pas le poignant tableau social brossé là, de peuples en quête de liberté certes, mais aussi de quelque richesse matérielle. L’arrivée au pays de la liberté est saluée par les officiers de l’immigration d’Ellis Island d’un bon coup de pied au derrière de notre Charlot.
L'ESCALE DU GUINEE
FRANSSOU PRENANT

1987
« L’Escale de Guinée, au titre splendide et juste comme le film, c’est l’escale de Franssou Prenant en Guinée, à Conakry. Elle ne sait même pas pourquoi elle est partie. La main calleuse du destin. Elle se doute seulement que voyager ce n’est pas regarder un coucher de soleil depuis son rocking-chair. Elle part c’est tout. En Afrique, peut-être parce que son prénom sonne comme un prénom africain, mais ça, elle ne le dit pas. Si sûre de rien, sauf de l’incongruité mystérieuse de partir, elle peut alors vivre et raconter ce voyage dans les meilleures dispositions qui soient. On pourrait transposer son état à celui du meilleur écrivain qui commence un livre en sachant la grandeur et l’inutilité de la littérature. Je ne fais que me déplacer, dit-elle comme l’écrivain qui dit : « je ne fais qu’écrire un livre. » Elle parle et montre ce qu’elle vit, a vécu, aurait voulu vivre là-bas avec deux piliers : la vérité de son état d’âme du moment et l’idée constante de ne pas nous raconter n’importe quoi qui nous tromperait sur ce qu’est un voyage en Afrique, une escale dans une vie. Elle réécrit des mots magnifiques qu’elle dit facilement puisqu’ils sont justes. Et sa voix sonne comme un tam-tam. » (Christine Van de Putte, extrait)
ETRANGES ETRANGERS
MARCEL TRILLAT & FRANCOIS VARIOT

1970
Dans la nuit du 31 décembre 1969, cinq travailleurs noirs meurent asphyxiés dans un foyer pour travailleurs immigrés à Aubervilliers. Dans le contexte de l’après 68, ce drame va connaître un retentissement national à la fois médiatique et politique. Marcel Trillat et Frédéric Variot, au sein d’une coopérative fondée par des journalistes chassés de la télévision après les évènements de Mai 68, Scopcolor, réalisent alors Etranges Etrangers, un documentaire qui montre sans fard les bidonvilles et taudis d’Aubervilliers et de Saint-Denis, et qui comprend un morceau d’anthologie : un entretien avec Francis Bouygues, le patron du BTP.
FERRAILLES D'ATTENTE
TARIQ TEGUIA

1998
Plus de dix ans et quelques autres films plus tard, ce court film apparaît comme un premier geste de cinéma qui est celui que l’on reconnaît, de Tariq Teguia. La profonde mélancolie mêlée de rage à peine contenue qui baigne ses films suivants est déjà là. De longs travellings heurtés balaient le paysage de constructions inachevées, d’usines désaffectées, de plages désertées, de tiges d’acier plantées dans des blocs de béton, de structures métalliguqes désossées. La bande-son fait sonner en continu les bruits métalliques de chantiers en une symphonie ruisselante de détresse. L’image vient s’ajuster au son et, comme des silences lourds sur cette partition, des photographies noir et blanc font surgir un visage, un lieu en attente. Quelques fragments de textes s’intercalent dans les images « Machine à survivre », « Subversion d’usage », « Biens vacants »…. Ferrailles d’attente est une métaphore de l’Algérie de Téguia, une sorte d’essai philosophique en images, un « après le déluge » rimbaldien, une méditation sur le monde. En chantier ou en perdition ?
LA FORTERESSE
FERNAND MELGAR

2008
Des femmes, des hommes et des enfants, Roms, Togolais, Géorgiens, Kosovars ou Colombiens, affluent chaque semaine aux portes de la Suisse. Ils fuient la guerre, la dictature, les persécutions ou les déséquilibres climatiques et économiques. Après un voyage souvent effectué au péril de leur vie, ils sont dirigés vers l’un des cinq Centres d’enregistrement et de procédure parmi lesquels celui de Vallorbe. Dans ce lieu de transit austère, soumis à un régime de semi-détention et à une oisiveté forcée, les requérants attendent que la Confédération décide de leur sort.
ICI, LA BAS
DOMINIQUE CABRERA

1988
Ici : la France, 1987. Là-bas : l’Algérie, 1963. Entre les deux, Dominique Cabrera grandit et se fait sa propre idée de la guerre d’Algérie et du départ des pieds noirs. Entre les deux, il y a ses parents qui ont gardé le même sentiment d’injustice et n’ont pas accepté que l’Histoire bouleverse ainsi leur vie. Entre ces deux dates, entre ces deux pays, entre ses deux parents, Dominique Cabrera tente de forger une réflexion qui tienne compte de ses convictions politiques de femme « de gauche », et de l’intime compréhension qu’elle a de la douleur de ses parents. Comment vivre avec cet héritage ? Dominique Cabrera interroge ici ses propres parents.
INLAND
TARIQ TEGUIA

2009
Inland raconte une histoire: celle d’un topographe d’une quarantaine d’années, Malek, que l’on charge de reprendre les tracés d’une ligne électrique dont la construction a été abandonnée depuis une dizaine d’années parce qu’elle traversait une zone de l’Ouest du pays terrorisée par les islamistes. Malek y trouve l’empreinte des violences du passé, des violences qui couvent toujours et peuvent renaître à chaque instant. La peur et la mort planent. Malek y rencontre une jeune Malienne, Mellila qui cherche à aller vers le Nord. Il décide de l’aider.
HIGHWAY
SERGUEI DVORTSEVOI

1999
La steppe kazakhe dans son immensité désolée. A gauche, une citerne. A droite un bidon. Au milieu, un veau. Attiré par le contenu du bidon, l’animal se penche et lape joyeusement. Enhardi, il enfonce profondément sa tête dans le contenant métallique. Ce qui devait arriver arrive: le veau assoiffé se retrouve coincé dans le bidon – c’était écrit depuis Esope. Deux enfants, puis un troisième plus petit, puis le papa, et la maman entrent successivement dans le champ pour aider l’imprudent à se défaire de son heaume hermétique. Corrida kazakhe! Et bing contre la citerne! Et meuh! Il y a du slapstick dans cette scène comique, mais qu’un metteur en scène: le hasard. Cette première séquence de Paradise résume l’art de Dvortsevoy : savoir filmer avec le hasard. Et capter ce qui se passe parfois, là-bas, au fond de la steppe kazakhe.
ITALIANAMERICAN
MARTIN SCORCESE

1974
En 1973, la même année qu’Alice n’est plus ici, Scorcese réalise ItalianAmerican un documentaire tourné avec ses parents, dans l’appartement new-yorkais où il avait grandi. A l’origine, ce film devait faire partie dans une série intitulée Storm of strangers (tempête d’étrangers) consacrée aux immigrants et aux minorités raciales. Tourné dans le temps imposé d’un déjeuner familial dominical ordinaire, autour d’un plat de spaghetti, ce film apparemment modeste recèle une bonne partie de ce qui fait le talent et la matière romanesque du cinéaste. Le rapport de tendresse moqueuse qui règne chez les Scorcese, la dualité vitale de ces migrants siciliens, la personnalité de maman Scorcese…
LATCHO DROM
TONY GATLIF

1993
Voyage aux sources de la culture rom, où Tony Gatlif, gitan d’origine algérienne, passe en revue toutes les déclinaisons et toutes les instrumentations possibles de la musique tzigane à travers du Nord-Ouest de l’Inde, en passant par l’Egypte, la Turquie, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et la France. Mille ans d’histoire marquée par la haine et le rejet de ces peuples qui jouent leur vie et expriment leurs sentiments jusqu’à la folie. "Latcho Drom" signifie "bonne route ».
LES LETTRES DE TOUSSAINTE
NADINE FISHER
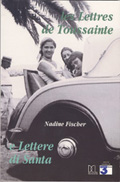
1998
Le film raconte l’histoire de Toussainte Ottavi-Wurmser. Née avec ce siècle, Toussainte est originaire d'un village de Corse du Sud, Ventosa. Dans les années 20, elle entame une carrière d'institutrice, au Maroc d'abord, puis en Indochine. Elle revient prendre sa retraite au village dans les années 60. Avec l'arrivée des pieds-noirs, c'est une époque de cassure et de mutation pour l'île qui conduira 15 ans plus tard à la montée des mouvements autonomistes puis nationalistes. Toussainte meurt, le 22 août 1975, le jour d'Aleria, date symbole de l'Histoire corse. À travers les lettres adressées à son frère Jean, c'est une partition à une voix avec son intimité et sa pudeur, ses non-dits et ses ellipses.
MADAME L'EAU
JEAN ROUCH

1992
À la recherche des solutions pour lutter contre la sécheresse au Niger, Lam, Damouré et Tallou partent en Hollande, le pays de l’eau et des moulins. Ils ramènent dans leurs bagages un ingénieur néerlandais et le moulin démontable dont il est l’inventeur. Les péripéties de l’installation de cet engin moderne fournissent à Jean Rouch une libre narration où sa poésie et son humour font merveille sans pour autant trahir le regard ethnographique. Ce film a reçu le prix international de la Paix à Berlin en 1994.
MME VEUVE ISOPPO
DANIEL ISOPPO

1980
« Mme veuve Isoppo, ma mère, fait le récit de son histoire d'amour avec Mr Isoppo, mon père. » C’est ainsi que Daniel Isoppo résume ce court film travaillé au plus près de l’univers familial. Dans les années trente, près de Grenoble, une jeune fille, fille de bistrotier, rencontre un immigré italien sans papiers. Il la fait danser comme personne. Il lui apprend l’amour. Elle deviendra Mme Isoppo. Cinquante ans plus tard, Mme Isoppo désormais Veuve Isoppo entreprend la récit de toute une vie, la rejouant devant la caméra de son fils. Mise en scène dans ses lieux, ses objets, elle est comme un personnage d’un vieil album de photos de famille que l’on ne peut regarder sans sentir le souffle du temps. Daniel Isoppo a réalisé là un petit bijou de tendresse filiale, de respect pour une si belle histoire d’amour, pour deux belles personnes qui ont construit leur vie sur un véritable élan amoureux, qui ont traversé l’Histoire dignement. Dans la sublime modestie de « petites gens » comme disent certains.
MA' ALOUL FETE SA DESTRUCTION
MICHEL KHEIFI

1985
Ce documentaire est le second film d’une trilogie entamée avec La mémoire fertile (1980) et bouclée avec Noce en Galilée (1987). Le film décrit la journée rituelle de l’année où des anciens villageois palestiniens reviennent sur les ruines de leur village de Maaloul, qui fut détruit par l’armée israëlienne en 1948. La cruelle ironie étant que ceux-ci n’autorisent l’entrée des lieux aux Palestiniens que le jour anniversaire de la création de l'Etat d'Israël.
LE MARCHEUR
JEAN-NOEL CRISTIANI

2009
« Le marcheur ne choisit pas les sentiers pour faire des rencontres. Elles sont rares sur ces chemins que presque personne n’emprunte plus. Si c’était le but de sa marche, il serait parti dans un pays où les chemins sont fréquentés, car utiles à la vie. Souvent je marche, en compagnie d’une caméra. Des paysages que je rencontre me donnent envie de raconter des histoires à mes enfants. Des histoires de cinéma. « L’art du sommeil », disait Langlois. Comme la marche ? » (Jean-Noël Cristiani)
NO COMMENT
NATHALIE LOUBEYRE

2008
Afghans, Irakiens, Palestiniens, Kurdes, Soudainais, six ans après la fermeture du centre de Sangatte, ils sont toujours aussi nombreux. Seulement 4 à 5% d’entre eux obtiendront le statut de réfugié en Grande-Bretagne. Les autres seront condamnés à la clandestinité. A part quelques associations de bénévoles, la population les ignore, feint de ne pas les voir. Les chaînes thématiques conscrées aux actualités ont parfois des « absences ». Des images et des sons bruts d’évènements sont livrés sans explication, juste avec un encart indiquant le lieu et éventuellement la date, l’intuition étant que ces images et ces sons seuls trahissent quelque chose du réel que les mots étouffent, qu’il y a une information spécifique et précieuse dans la nature informe des matériaux. No comment procède de cet esprit..
NULLE PART, TERRE PROMISE
EMMANUEL FINKIEL

2009
Trois personnages sillonnent l’Europe d’aujourd’hui. Un jeune cadre supervise la délocalisation d’une usine. Une étudiante joue au reporter en attendant l’appel d’un amour perdu. Un Kurde et son fils essaient de rejoindre l’Angleterre clandestinement. Vers l’est ou vers l’ouest, en camion, en business class, en stop, en train, avec ou sans papiers, à travers l'Europe contemporaine, chacun en quête de sa terre promise. Prix Jean Vigo 2008.
LES OUBLIES DE CASSIS
SONIA KICHAH

2008
La « carrière Fontblanche est l’un des derniers bidonvilles de France en bordure de Cassis. Un village sans nom, sans enfants, ni femmes, qui abrite des Tunisiens venus dans les années 1970, contrat en main, pour construire les villas de la cité balnéaire. En octobre 2005, le village improvisé et insalubre où ils habitent depuis 35 ans est détruit pour être remplacé par une résidence sociale. Ce documentaire donne la parole à -certains de ces hommes fragilisés par des année d’exil, de sacrifices, d’abnégation de leur vie pour subvenir aux besoins de leurs familles restées au pays. Ils ont fini par faire une vie ici, dans ces cahutes de fortune et même une sorte de village. La perspective du nouvel habitat est pour eux un nouveau déchirement.
PARADISE
SERGUEI DVORTSEVOI

1995
La steppe kazakhe dans son immensité désolée. A gauche, une citerne. A droite un bidon. Au milieu, un veau. Attiré par le contenu du bidon, l’animal se penche et lape joyeusement. Enhardi, il enfonce profondément sa tête dans le contenant métallique. Ce qui devait arriver arrive: le veau assoiffé se retrouve coincé dans le bidon – c’était écrit depuis Esope. Deux enfants, puis un troisième plus petit, puis le papa, et la maman entrent successivement dans le champ pour aider l’imprudent à se défaire de son heaume hermétique. Corrida kazakhe! Et bing contre la citerne! Et meuh! Il y a du slapstick dans cette scène comique, mais qu’un metteur en scène: le hasard. Cette première séquence de Paradise résume l’art de Dvortsevoy : savoir filmer avec le hasard. Et capter ce qui se passe parfois, là-bas, au fond de la steppe kazakhe.
QUADIR, UNE ODYSSEE AFGHANE
ANNETA PAPATHANASSIOU
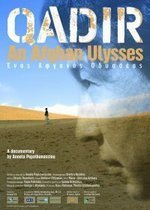
2008
Qadir est un réfugié afghan venu, il y a neuf ans, chercher une terre d’asile en Grèce après que les talibans eurent envahi sa ville. Il y a trouvé du travail, un logement mais aujourd’hui, il veut retrouver sa famille dont il n’a aucunes nouvelles. C’est ce retour au pays que suit la réalisatrice, se mettant elle-même en scène dans ce périple dans une terre toujours en guerre. Elle partage avec Qadir la longue enquête qui le mène dans différentes villes afghanes avant de retrouver sa famille dans un village de montagne. Le pays traversé est détruit, les gens semblent perdus, les talibans sont partout, les armes de guerre, la misère, aussi. C’est le regard d’un Qadir qui retrouve sa peur d’enfant obligé de fuir que nous transmet le film. C’est aussi celui de la cinéaste, obligée de revêtir le tchador bleu pour circuler avec son compagnon. Le film vaut pour l’incroyable aventure de ces deux personnages projetés au pays des talibans et pour la rencontre avec la famille de Qadir. Un grand moment de beauté dans un univers de sauvagerie moderne.
RECIT D'ELLIS ISLAND
ROBERT BOBER & GEORGES PEREC

1979
Désormais monument national, Ellis Island est un ilôt de quatorze hectares, situé à quelques enc^blures de la point sud de Malhattan. A partir de 1892, il fut le passage obligé de la grande majorité des candidtas à l’immigration aux Etats-Unis. En 1924, seize millions de personnes en provenance d’Europe avaient transité par le Centre d’immigration d’Ellis Island, plus de trente millions à sa fermeture en 1954, et à l’heure actuelle, 40% des Américains comptent, parmi leurs ascendants directs, au moins l’une d’entre elles. En 1978, Robert Bober et Georges Perec ont voulu restituer ce que fut Ellis Island. C’est à dire, pour Perec « le lieu même de l’exil, le lieu de l’absence de lieu, le non-lieu, le nulle part ». Ils sont allés sur place, filmer ce qui restait de cette « porte d’or » que les immigrants avaient surnommée « l’île aux larmes ». Ils voulaient également comprendre en quoi et pourquoi ils se sentaient tous deux aussi directement concernés. Ainsi, au-delà d’Ellis Island, ces Récits sont une formidable réflexion, sur l’exil d’abord, avec sa part d’errance mais d’espoir aussi. Et sur la puissance symbolique des lieux de mémoire.
ROME PLUTOT QUE VOUS
TARIQ TEGUIA

2006
« Les nouvelles du cinéma algérien se font rares. En voici une, excellente. Le motif du film n'est pas inconnu : un pays-prison, à la beauté captivante, à l'horizon irrémédiablement fermé, avec sa jeunesse qui tourne en rond et voudrait faire exploser les murs en rêvant d'exil. Sauf que cette histoire, on ne nous l'a encore jamais racontée comme ça, de manière si moderne, si inspirée, si altière, en un mot si remarquable pour un premier long métrage. Un soupçon de Beckett, pour l'attente prolongée et l'absurde circulaire façon Godot. Une pincée de Godard pour l'art inattendu de mettre malgré tout les choses en rapport et en mouvement, à la manière d'un transport clandestin du désir. En l'occurrence, pour faire simple, celui d'un garçon et d'une fille. Lui, c'est Kamel, elle Zina. Il a la rage au ventre, elle est gracieuse comme une gazelle. Ils sont jeunes, ils sont beaux, mais ils sont malades, d'une maladie qui leur ronge le coeur et qui s'appelle la mélancolie. Ils s'ennuient à mourir, se vivent comme incongrus dans ce paysage d'azur et de cendres, perclus de douleur, embourbé dans la léthargie de ce qui ne change jamais. » (extrait. Jacques Mandelbaum, Le Monde).
SHAWAKS
KAZIM OZ

2008
Kazim Öz a suivi pendant plus d’un an le quotidien des Shawaks, sa tribu, peuple kurde semi-nomade vivant au rythme des transhumances et des caprices de la montagne. Avec eux, une armée invisible et muette –milliers de moutons, mules et chevaux chargés à en crever- que le cinéaste scrute en une série de travellings inouïs de beauté, à flanc de près, ruisseaux et montagnes, dans la boue, la poussière ou la glace. « Dans la culture shawak, les hommes, les animaux et la nature vivent en parfaite harmonie. Impossible de ne s’intéresser qu’aux humains sans trahir ce grand tout. » précise l’auteur. L’élégie pastorale laisse bientôt place à une sorte de mélodrame animal halluciné et silencieux. (Extrait. Vincent Malausa. Les Cahiers du cinéma)
LA TRAVERSEE
ELISABETH LEUVREY

2006
Chaque été, ils sont nombreux à transiter par la mer entre la France et l’Algérie. De l’Algérie vers la France, ici. Les voitures sont chargées jusqu’au capot, valises et paquets s’entassent sur le pont. Dans l’entre-deux de la traversée, les conversations dans les cabines, les salons ou sur les ponts parlent toutes de départ et de pays. Certains vont en France pour la première fois, d’autres terminent de brèves vacances au « bled ». Les plus âgés transportent avec eux les récits de la vie en France et l’espoir de trouver un avenir. Celui qui « monte » pour la première fois écoute et apprend de celui qui a déjà « traversé ». Avec l’humour de la lucidité ou du fatalisme, et la conscience du déchirement, une autre manière de dire et de voir l’immigration prend forme dans le temps du voyage. Un passager rêve : « l’idéal serait de faire de deux mondes un troisième monde »
VOYAGE EN SOL MAJEUR
GEORGI LAZAREVSKI

2006
Un voyage initiatique à 91 ans ? C’est possible et Aimé Lazarevski nous le prouve avec élégance. Pendant des années, il a planifié minutieusement un voyage au Maroc. Mais sa femme ne veut pas entendre parler de voyages. Seule la musique l’emporte très loin. Alors c’est le petit fils, Georgi qui l’y emmène enfin, caméra à la main. On suit le vieil homme qui découvre le monde après avoir consacré sa vie au violon d’orchestre. La curiosité et la générosité de son regard intactes, il en reviendra transformé. La finesse du cinéaste a été de ne pas oublier sa grand-mère dans ce périple. Elle est une sorte de contrepoint malicieux et sublime. On peut aussi voyager dans un divan de cuir, en écoutant de la musique. (APG)
KADY LA BELLE VIE
CLAUDE MOURRIERAS

2008
Kady a 50 ans. Elle est arrivée de Côte d’Ivoire il y a 17 ans et elle élève seule ses 7 enfants à Paris avec un salaire de femme de ménage. Entre la joie et le désespoir, elle se bat quotidiennement pour qu’ils ne supportent pas ce qu’elle a enduré. « Même les blancs n’auraient pas supporté tout ça ! », dit-elle.
LE JARDIN DE JAD
GEORGI LAZAREVSKI

2007
Le film se déroule dans la maison de retraite Notre-Dame-des-Douleurs à Jérusalem. Ici vit l’énigmatique Jad, un vieil homme éternellement coiffé d’un bonnet et toujours en vadrouille. La construction du mur de sécurité, qui passe juste devant l’entrée du bâtiment, ne facilite pas le quotidien du home. Comme celui-ci se retrouve en zone israélienne, de nombreux pensionnaires voient s’espacer les visites de leurs proches qui résident pour la plupart en Cisjordanie et peinent à obtenir des laissez-passer. Quant au personnel, il doit effectuer un parcours du combattant pour venir travailler. Par des petits riens - un camion coincé, des graffitis désabusés -, le film suggère les tracas quotidiens de cette petite communauté coupée du reste du monde.
