THEMATIQUE// LE VILLAGE ET LE MONDE
LES
FILMS
A THE DATCHA
THIERRY PALADINO

Pologne, 2006, 30’, couleur, stf, Beta
Il y a la mère, le père et le fils. Une petite famille ouvrière polonaise que Thierry Paladino suit l’espace d’un été dans leur « datcha ». Une « maison de campagne » montée de tôle ondulée et matériaux de récupération par le père. Le reste de leur univers est à l’avenant. L’auto toujours en panne, les gouttières percées, les chaises branlantes, les murs en carton pâte… Le père étant sourd-muet, la famille triangulaire devient un sujet cinématographique étonnant sous l’œil de Thierry Paladino. Les signes, les gestes, les regards prennent une dimension insolite. A la fois pathétique et poétique. Et tout particulièrement dans ce moment de leur vie qu’a choisi de filmer le cinéaste. L’été, loin de l’usine, quand il s’agit juste pour eux d’être heureux dans un microcosme fabriqué par le père. Rien n’est facile pour ce petit monde pétri d’amour familial, mais en perpétuel bataille avec les éléments (la pluie, les tuiles, le moteur de la voiture…). Comme si la misère de leur vie d’ouvrier imprégnait jusqu’à la nature-même. Le trio est filmé sans commentaire, sans ricanement, par Thierry Paladino. Comme si le père imposait à tous un silence attentif et respectueux autour de lui. Légèrement à distance, le cinéaste restitue le quotidien familial avec une tendresse amusée. Sa caméra complice révèle leur vie modeste, les petits jeux entre eux, mais surtout elle en exhume le joyeux burlesque, et jamais le ridicule. C’est que la finalité du film est moins de nous faire rire des déboires matériels de cette famille de « branquignoles » que de nous montrer le père, la mère et le fils en train de préparer le barbecue comme on se bricole du bonheur.
A.P.G.
AU LOIN DES VILLAGES
OLIVIER ZUCHUAT

France-Suisse, 2008, HD, couleur, 75’
« En avril 2006, 13 000 personnes de l’ethnie Dajo se réfugient dans la plaine de Gourouko, à l’Est du Tchad. Tous sont survivants de la guerre du Darfour. Ils y construisent un camp, s’y enferment et s’y inventent une survie. Olivier Zuchuat s’est enfermé à son tour dans cette prison sans mur. En longs plans fixes, ses images recueillent les litanies, les récits, les complaintes, mais aussi les gestes et les postures de ces exilés. Car chacun semble ici œuvrer à se soustraire à la douleur. L’un se tient assis immobile comme pour éviter de remuer les souvenirs ; un autre s’invente, dans une même raideur, un mémorial vivant ; un autre encore, vêtu d’un kimono blanc immaculé, enchaîne à la perfection un kata de judo devant un adversaire invisible ; un gamin dessine les fresques stylisées des affrontements meurtriers ; des fillettes fredonnent de concert des hymnes belliqueux. La guerre est encore là, partout, sur les corps, dans les têtes. Même si seule son ombre pèse sur ce village fantôme ». (Jean-Pierre Rehm)
BANDITS D'ORGOSOLO
VITTORIO DE SETA

Bandits d’Orgosolo est un film de fiction, tourné trois ans après son court métrage documentaire, Bergers d’Orgosolo (voir fiche « films ») et sept ans après la parution de l’enquête de l’ethnologue Franco Cagnetta sur les habitants d’Orgosolo (Bandits d’Orgosolo, ed. Buchet Chastel). Ce film de fiction a pourtant tout à fait sa place dans le travail documentaire de Vittorio De Seta, en point d’orgue de ses dix courts métrages réalisés pendant les années 50 dans le sud de l’Italie. Une œuvre documentaire sur le peuple travailleur de ces régions pauvres. C’est avec ce fonds ethnographique riche et déjà empreint d’un souci narratif que De Seta tourne son premier long métrage de fiction.
Bandits d’Orgosolo est bien le prolongement des Bergers d’Orgosolo. Le film a été tourné au cœur de la montagne sarde, dans le village et les environs d’Orgosolo. Les acteurs en sont des bergers de la région. Inspiré par la mythologie du berger bandit d’honneur, De Seta a construit une histoire simple. Le drame d’un jeune berger conduit à prendre le maquis pour n’avoir pas dénoncé des voleurs. Mais cette évasion n’a rien d’ordinaire, le berger s’enfuyant avec tout son troupeau de chèvres. Cette belle idée scénaristique devient, avec la caméra de De Seta (il est aussi le chef opérateur de ses films), l’un de ces moments inoubliables du cinéma où le mythe s’incarne à l’image. Comme pour ses documentaires, De Seta travaille le lyrisme de son regard avec de sobres procédés. Il choisit là le noir et blanc, de rares dialogues, et nous emporte sur les traces du troupeau en fuite et de son berger aux semelles de vent.
A.P.G.
BERGERS D'ORGOSOLO
VITTORIO DE SETA

Pendant une dizaine d’années, de 1954 à 1959, Vittorio De Seta a filmé le travail « archaïque » des bergers sardes, des pécheurs du Détroit de Messine et des mineurs de Calabre. Une œuvre documentaire composée d’une dizaine de courts métrages remarquables, tournés en cinémascope, magnifiant la dignité et la beauté de ces travailleurs vivant pour la plupart dans des conditions misérables. Au sortir de la seconde guerre mondiale, une sorte de questionnement existentiel taraude les chercheurs et les artistes. Au début des années 50, des ethnologues italiens avaient fait le voyage dans les montagnes sardes pour y observer les bergers, « une peuplade de chasseurs et de cueilleurs du néolithique » comme l’écrit Alberto Moravia en 1963 dans la préface au livre de Franco Cagnetta, Bandits d’Orgosolo. «Pour la police, il ne s’agit jamais que d’un peuple de « bêtes féroces », de bandits… ». Un livre qui fut le résultat d’une longue enquête de sociologues menée à Orgosolo de 1950 à 1954.
Dépassant ce simple regard ethnographique ou cette quête de justice sociale, évidemment loin de toute folklorisation, Vittorio De Seta sublime ces travailleurs de la terre et de la mer, leur restituant leur dignité mais aussi une aura mythologique qui traverse le temps. A la manière d’un Robert Flaherty, il s’affranchit de toute contrainte documentariste ou réaliste pour atteindre une vérité et une beauté profonde de l’humanité. L’âpreté des montagnes sardes qui fait écho à l’âpreté de la vie des bergers est le décor idéal de cette fresque mythique d’une humanité qui défie le temps.
A.P.G.
CE CHER MOIS D'AOUT
MIGUEL GOMES

France-Portugal, 2008, 35mm, couleur, 227’
« Un grand coup d’air frais vient de traverser le festival ! écrit Jacques Mandelbaum, critique du Monde, à Cannes en mai 2008. Imaginez une odeur de foin coupé, la douceur frémissante d'un soir d'été, l'alcool qui vous tourne la tête, le premier baiser de deux adolescents dans les flonflons d'un bal populaire. Ça se passe dans le centre du Portugal, en deux temps dialectiquement reliés. » Et même en trois temps, tant Miguel Gomes s’ingénie à faire valser les genres cinématographiques. A l’origine de Ce cher mois d’août, il y a le projet d’une fiction qui pourrait se résumer par ces paroles d’un refrain populaire portugais : « Adieu mon amour/Le monde m’attend et le bonheur ne dure qu’un temps ». Un synopsis minimaliste qui trouve son décor idéal dans les bals d’été des villages. Un mois avant le tournage, le projet capote, mais Michel Gomes part tourner quand même, avec une caméra 16mm et une petite équipe. Ce sera la matière de la première partie du film, documentaire, mais aussi le moteur de la fiction qui s’ensuit. Ce sont ces mêmes musiciens de bals rencontrés au cours du tournage qui seront les acteurs de la romance du film.De cette obstination de tourner à tous prix émerge un film inclassable, foisonnant, où documentaire et fiction se lancent ensemble sur la piste de danse. Septembre est sans doute le mois idéal pour se laisser prendre à cette nostalgie enchantée des places de village transformées en salles de bal, des embrasements amoureux. « L'été dans cette région est un moment particulier, explique le cinéaste dans Télérama. Une époque d'euphorie et de sentimentalisme exacerbé, tous ceux qui ont dû partir pour travailler, dans les grandes villes ou à l'étranger, sont de retour. Et ils ont de leur pays une vision sublimée.»
A.P.G.
DITES A MES AMIS QUE JE SUIS MORT
NINO KIRTADZE

France, 2003, Beta SP, 90’
Tsotné vient de mourir. Revêtu, pour la circonstance, de son plus beau costume, il reçoit, au beau milieu du salon, ses parents et ses amis venus l’accompagner pour la préparation de son dernier voyage. En Géorgie comme en Corse et ailleurs, le deuil est ce moment précieux où l’on entoure le mort. Mais en Géorgie, on l’entoure aussi de ses biens les plus chers, de ses objets familiers. Tsotné, lui, aimait son automobile… Qu’à cela ne tienne, Tsotné aura sa voiture auprès de lui, sur le plancher du salon !
C’est ce rituel collectif du passage de la vie à la mort, préservé dans son exubérance théâtrale que filme intimement Nino Kirtadze. On y retrouve l’antique mise en scène d’une profonde croyance dans le lien qui unit les vivants et les morts. Un lien d’amour et de crainte. On pleure ces morts qui furent des vivants chéris, on prie déjà ces morts qui dans l’au-delà acquièrent un pouvoir inconnu. Cette énigme fondamentale rejouée ici entre rite païen et tradition religieuse est le sujet de ce très beau film où l’on pleure, où l’on chante, et surtout où l’on boit à la santé de nos fantômes.
A.P.G.
ECLAIRS D'ETE
NICOS LIGOURIS
Grèce, 2004, Beta SP, couleur, 80’
Chaque printemps, la famille descend de ses collines d’oliviers pour tenir pension pendant quelques mois au bord de la plage de cette côte crétoise. Durant toute la période estivale, les paysans que sont le père, la mère, le fils et la belle-fille sont les hôtes étonnés d’une espèce humaine étrange : les touristes. Le père, qui n’a qu’un œil, n’est pas le moins observateur des quatre. Avec son ami, philosophe et motard, il médite sur ces singuliers rapports humains modernes où le soleil se marchande sans vergogne. Et comme il est, lui aussi, un peu philosophe, il détourne la situation de belle façon. Profitant qu’un touriste allemand a oublié un appareil photo dans sa chambre, le patron installe l’appareil devant l’hôtel, juste face à l’horizon. Son rêve : prendre en photo un de ces éclairs d’été qui fend le ciel sans un bruit.
Nicos Ligouris filme cette fable philosophique comme une petite chronique familiale toute simple. Bientôt, c’est avec l’oeil perplexe de ce paysan crétois que l’on regarde passer les touristes en short, cramant sous ce soleil qu’ils payent si cher. Et, de l’autre côté de la route, toute une famille crétoise participe d’un autre rêve de soleil. Chacun à son tour, ils traversent la route pour appuyer sur le déclic de l’appareil photo. Ils remonteront à l’automne dans leurs champs d’olivier. Sans avoir attrapé l’éclair d’été.
A.P.G.
EMERALD
APICHATPONG WEERASERTHAKUL

Thaïlande, 2008, Beta SP, 11’
Dans Le pélerinage de Kamanita, roman bouddhiste écrit en 1906 par l’auteur danois Karl Gughellerup, les protagonistes se réincarnent en deux étoiles et se récitent leurs histoires pendant des siècles, jusqu’à ne plus exister. Le Morakot est un hôtel en fin de vie, délabré, au coeur de Bangkok. Il ouvre ses portes dans les années 1980, alors que la Thaïlande passe à la vitesse supérieure de l’industrialisation économique et que des vagues de Cambodgiens affluent dans les camps de réfugiés thaïlandais après l’invasion de l’armée vietnamienne. Plus tard, lorsque la crise financière frappe l’Asie de l’Est, en 1997, les rêveries s’effondrent.
Tout comme Kamanita, le Morakot est immuable, une étoile alourdie (ou nourrie) par les souvenirs. Apitchapong Weeraserthakul a travaillé avec trois de ses acteurs habituels qui ont raconté leurs rêves, la vie de leur ville, les mauvais moments et les poèmes d’amour, pour offrir à l’hôtel de nouveaux souvenirs.
ESSAI D'OUVERTURE
LUC MOULLET

France, 1988, Beta SP, 11’
Vingt-et-une tentatives...
Vingt-et-une manières d'ouvrir une bouteille de Coca-Cola.
P.S. « Tout l’art de Luc Moullet consiste à jouer au jeu réglé de la logique avec un impayable sens de l’humour (mais un humour pince-sans-rire, une drôlerie à froid, que le cinéaste partage avec Buster Keaton et Aki Kaurismäki) afin de la dérégler en la prenant au piège de sa propre raison raisonnante. L’ambition, en fait ici extrême, vise bel et bien à l’ébranlement du socle rationaliste de nos habitudes sociales bouclées sur elles-mêmes et comme ossifiées, en fait tellement rassurantes à force de ne plus jamais être questionnées » (Saad Chakafi, Les Cahiers du cinéma, août 2008).
EUX ET MOI
STEPHANE BRETON

France, 2005, Beta SP, 63’
Ethnologue, Stéphane Breton a vécu plusieurs années chez les Wodani des hautes terres d'Irian Jaya (Nouvelle-Guinée indonésienne). Il parle leur langue, mais ce n’est pas pour autant que les échanges sont faciles entre eux et lui. Et c’est justement d’échange dont il est question dans ce film. Des échanges entre eux (un coquillage pour la mâchoire d’une fiancée, un autre pour son cœur : on paye la jeune fille en morceaux par des coquillages). Des échanges avec lui : « Tu nous observes, tu nous filmes. Que nous donnes-tu en contre-partie ? » Les coquillages et les billets circulent entre l’ethnologue et les Wodani. Une manière de lui rappeler qu’après tout, ils vivent bien dans ce même monde que lui.
Dans ce film profond et cocasse à la fois, Stéphane Breton nous montre là ce qu’on voit rarement du travail de l’ethnologue. Non seulement la petite cuisine de monnayage (version moderne du don/contre-don) mais aussi et surtout il nous révèle une communauté dans toute sa diversité. Des individus et non des « objets d’étude »
A.P.G..
FATA MORGANA
ANASTASIA LAPSUI & MARKKU LEHMUSKALLIO
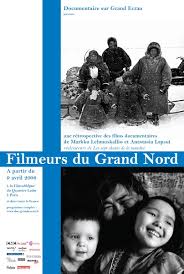
Finlande, 2004, Beta SP, couleur, VO stf, 57’
Sur la côte du détroit de Bering, les Tchouktches sont les habitants les plus orientaux d’Asie. Ils ont vécu dans des conditions extrêmes pendant des siècles grâce à la pêche au phoque. Jusqu'à ce qu’ils soient englobés dans l’empire soviétique. Aujourd’hui, face à l’alcoolisme et au chômage, une nouvelle génération tchouktche est déterminée à sauver sa culture. C’est cette révolte d’un peuple qu’évoque ce film par le portrait de femmes décidées à réapprendre leur langue d’origine, des images du début du 20e siècle et, initiative rare dans un documentaire, la reconstitution de mythes en images d’animation. Les films de Anastasia Lapsui et Markku Lehmuskallio constituent une œuvre à la fois poétique et politique, dont le style singulier, usant des formes documentaires comme de celles de la fiction ou de l’animation, est habité de l’imaginaire de ces ethnies du Grand Nord.
GARE DU NORD
JEAN ROUCH

France, 1964, Beta SP, couleur, 16’
Gare du Nord est un sketch tourné pour le film Paris vu par… réalisé avec Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Jean Douchet, Jean-Daniel Pollet et Eric Rohmer. Un des rares films de Rouch tourné hors de l’Afrique, hors de sa tribu de cinéma.
« Gare du Nord est un envers critique, violemment fictionnel, du pseudo cinéma-vérité : le délayage, la dérive, le caractère digressif, l’aspect « chronique » cèdent la place à un surprenant effet de condensation, au sens onirique du terme, peut-on ajouter. Ainsi l’expérience du cinéma-vérité s’inscrit-elle comme la recherche, non pas du temps perdu, mais d’un réel en déperdition constante entre réel rêvé et réel raté… Un réel envisagé non comme un état des choses mais comme potentiel de modifications, que seuls nos fabulations, nos échanges, nos crises de possession et d’identité peuvent entre-tenir et activer. » (Jean-André Fieschi, cinéma théories lectures, Klincksiek 1978)
GENESE D'UN REPAS
LUC MOULLET

France, 1978, Beta SP, couleur, 117’
Sur la table, devant le réalisateur assis, quelques aliments. Des oeufs, du thon, une banane. C’est le point de départ d’une vaste enquête de par le monde sur la « genèse » du repas du cinéaste. Il remonte la filière alimentaire et la chaîne économique de l’œuf, du thon et de la banane. Jusque dans les pays du Sud où sévissent les chaînes capitalistes de production et de consommation de ces aliments qui finiront dans son estomac.On est en 1978, et le propos de Luc Moullet est alors moins de type « écologique » que social. Ce qui le taraude, c’est la différence de traitement des travailleurs de ces pays qu’on appelait alors le Tiers-Monde. On peut y voir aujourd’hui une vision prémonitoire de ce qui agite les mouvements écologistes ou altermondialistes. Mais aussi, on retrouve là le souci premier du cinéaste de Essai d’ouverture. Travaillé au corps par cette pulsion élémentaire qu’est la faim. « Son grand sujet, à la fois personnel et universel », comme le disait le critique Serge Daney.
IRAQI SHORT FILMS
MAURO ANDRIZZI

Argentine, 2008, couleur, 93’
« De la situation en Irak on sait au moins ceci : d’un côté, les troupres américaines et leurs alliés, en armée constituée ; de l’autre, un nombre estimé à 140 bandes armées de milices iraquiennes mènent la résistance contre l’occupant. En dehors des rares images officielles, chacun des camps produit une importante quantité de vidéos de fabrique rudimentaire destinées à circuler sur le Net ou à l’intérieur de circuits plus choisis. Propagande méthodique et ciblée ou défouloir débridé, ces images relatent à leur façon, implacable, myope et grossière, le conflit. Comme en un écho lointain du Redacted de Brian De Palma. Mauro Andrizzi a collecté pendant quatre mois de telles séquences. On y trouve des clips chantés, des moments de guêt à attendre l’explosion escomptée, des instructions de pose de bombe, des revues d’armes, du gymkhana de 4X4 dans Bagdad, etc. Le quotidien guerrier saisi dans la brutalité sèche d’un viseur transformé en objectif, sans la respiration jamais d’aucun contrechamp . Là réside le caractère éprouvant de l’expérience, qui épargne d’adjoindre un quelconque macabre. Car c’est le montage de ces sinistres moments de théâtre qui nous est proposé, avec pour seul commentaire quelques citations, de T.E. Lawrence à Dick Cheney, en passant par Mark Twain. Dialogue étrange entre ces scènes juxtaposées, dialogue aveuglant, d’où transpire néanmoins en continu la violence et celle, spécifique, de ses imaginaires nationaux. » (Jean-Pierre Rehm)
JOE LEAHY'S NEIGHBOURS
BOB CONNOLLY & ROBIN ANDERSON

Australie, 1988, Beta SP, couleur, 90’
Joe Leahy’s neighbourgs est le deuxième volet de la trilogie consacrée à la colonisation de la tribu Ganigas de Nouvelle-Guinée. Dans le premier volet, First contact, ils ont travaillé à partir des images tournées dans les années 30 par les trois frères Leahy au cours de leur expédition de chercheurs d’or. Connolly et Anderson sont retournés sur place pour montrer ces documents aux Papous et filmer leurs réactions. Fils naturel de l’un de ces premiers explorateurs australiens de la Papouasie Nouvelle-Guinée et d’une indigène, Joe Leahy dirige aujourd’hui une plantation de café prospère et mène une vie à l’occidentale. Il doit son ascension sociale en partie à l’habileté avec laquelle il tire profit de ses voisins immédiats, les Ganigas, qui, près de cinquante ans après l’arrivée des blancs, fonctionnent encore dans le système tribal traditionnel, tout en étant tentés par le bien-être matériel et la consommation. A travers les démêlés entre Joe Leahy et ses voisins, se dessine de façon à la fois cocasse et explosive le problème de la colonisation.
KOTO CORSE
YANN DEDET
France, 2008, DVD, couleur, 60’
Le Japon est le territoire des films de Yann Dedet-réalisateur. Cette fois-ci, c’est en Corse qu’il filme, suivant les déplacements de la chanteuse japonaise, Mieko Miyazaki. Une interprète de chants traditionnels japonais, le koto. Du nom d’un instrument à cordes qui fut importé de Chine au Japon vers le 7ème siècle. La partie vocale est constitué de longs poèmes du répertoire. En juillet 2007, Mieko Miyazaki rencontrait le groupe corse Voce Ventu dans le Cap Corse pour la préparation d’un concert ensemble.C’est cette rencontre que filme Yann Dedet. Au plus près de leurs échanges musicaux et culinaires. Jusqu’au concert lui-même, où des chansons du groupe corse sont accompagnées par la musicienne et des chants traditionnels japonais sont interprétés en japonais par le groupe ou adaptés en Corse. Les voix des îles se mêlent.
LE GOUT DU KOUMIZ
XAVIER CHRISTIAENS

Belgique, 2003, Beta SP, couleur, 55’
Dans les années 30, l’empire soviétique avait entrepris la collectivisation des terres. Les nomades Kirghises, éleveurs de chevaux, ont été contraints de rejoindre les fermes collectives (kolkhozes). Ceux qui ne se soumettaient pas voyaient leurs troupeaux confisqués et étaient envoyés en déportation dans des camps de travail. Kolia, dont le père a été déporté dans ces années noires, tente de rassembler sensations et souvenirs de son enfance. Une enfance de nomades brutalement bouleversée par cette déportation du père. Kolia se retrouve recueilli par une tante qui habite en ville. C’est cette douloureuse rupture qu’il cherche à ré-interroger aujourd’hui. « Mais sa mémoire, suturée au fer rouge, bute contre un mur… » (dixit le synopsis). Xavier Christiaens aborde cette histoire comme un voyageur en errance dans un pays inconnu, au bord de la disparition. Comme un véritable voyageur, il semble poreux à cette vaste nostalgie de la vie nomade qui émane de ces paysages grandioses. Son parti-pris n’est pas de « documenter » la culture nomade et sa mort annoncée. Il se la réapproprie pour en tisser une une fable poétique, hallucinatoire, sur le devenir humain.
A.P.G.
LE JOUR DU PAIN
SERGUEI DVORTSEVOY

Russie, 1998, Beta SP, couleur, 55’
Le film s’ouvre sur un plan séquence long comme un jour sans pain. Evidemment. Un plan de 8 minutes qui suit, dans un lent travelling en temps réel, l’effort de quelques bakushka pour pousser un lourd wagon de bois abandonné par sa locomotive à quelques centaines de mètres de leur village. On a tout le temps de remarquer leur dos voûté par la fatigue, leurs grosses semelles qui crissent dans la neige, leur connivence dans l’effort. Tout le temps aussi de se demander ce qu’il peut y avoir de si précieux dans ce wagon. Et quand le wagon s’ouvre sur quelques miches rectangulaires de pain brun, on est saisi par la force de ce pur moment de cinéma qui nous renvoie tout droit à la condition humaine. Nous sommes à une petite centaine de kilomètres de Saint-Petersbourg, dans un village abandonné du monde où vivent quelques vieux paysans. Magistralement attaqué, le film poursuit sa lente observation dans les rues désertées du village, dans les étables, dans l’épicerie où, le pain étant enfin arrivé, se jouent les échanges improbables entre ces survivants d’un cataclysme mystérieux. La caméra de Serguei Dvortsevoy semble dotée d’un pouvoir magique, tant elle confère, par sa sourde attention, une puissance poétique à ces moments de banalité et de misère.
LES HOMMES
ARIANE MICHEL

France, 2006, couleur, Beta, 95’
Pendant deux mois et demi, Ariane Michel a suivi une expédition scientifique au Groenland à bord du Tara. Avec un projet de film. Le projet s'appelait "l'intrus".
« C'était un texte de deux pages, dit-elle, qui en gros présentait le film comme ça : "Nous, la glace, les pierres, les bêtes, le paysage... Eux les scientifiques. Nous regardons les humains, et on les perçoit d'abord comme une chose étrange, comme une menace. Et petit à petit, on voit qu'ils ne font rien d'inquiétant, puis finalement, rien de dangereux, et puis la nature va accepter les hommes." C'est presque littéralement le film que j'ai fait. »
LETTRE A LA PRISON
MARC SCIALOM

France, 1969, couleur et N&B, 70’
Avec Sonia Bandeira, Fabio Oliveira, Joaquim Carvalho.
Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes et au FID Marseille (2008)
Un jeune Tunisien débarque à Marseille. Il doit le lendemain, prendre le train pour Paris, il y renoncera à plusieurs reprises, et tout le film se passera en attentes et en errances dans les rues de Marseille. Apparemment, le nouveau venu n’est pas en quête d’un travail ; sa famille, en fait, l’envoie au secours d’un frère ainé qui vit une situation terrible, mais imprécisée. On apprendra peu à peu que le frère avait aimé, à Tunis, une jeune Française ; qu’il l’a revue plus tard à Paris ; qu’à présent la jeune fille est morte et que son amant est accusé de l’avoir assassinée ; enfin que cette accusation est probablement fausse. Or, toute cette histoire d’amour et d’assassinat se déroule dans le cerveau du jeune voyageur et se mêle à des fantasmes qui mettent en œuvre un Paris imaginaire, des souvenirs tunisiens et une réalité présentement vécue à Marseille. Le film a été réalisé en 1969, entre Tunis et Marseille. A l’époque, sans aucun soutien; le réalisateur franco-tunisien d’origine italienne a dû s’arrêter avant le tirage d’une copie. Aujourd’hui ce film, marqué des cicatrices de son rejet est, de ce fait-même, un témoin inégalé à ce jour de l’histoire de l’immigration en France : un film de fiction, d’une qualité artistique aujourd’hui flagrante, réalisé par un émigré (un exilé) entre Tunisie et France. Le film a été retrouvé par Chloé Scialom, réalisatrice elle-même, et exhumé avec le collectif d’auteurs de Film Flamme, comme un moment essentiel de notre histoire cinématographique, sociale et politique. » (Marc Scialom)
L'ILE AUX FLEURS
JORGE FURTADO

Brésil, 1989, Beta SP, 12’
En 1989, Jorge Furtado est chargé par l’université de Rio Grande do Sul de réaliser une vidéo sur le traitement des déchets. Choqué par ce qu’il découvre tout près de chez lui (il vit à Porto Alegre), il met huit mois pour écrire un scénario auquel il donnera cette forme étonnante, sardonique, comme si, pour lui, la dérision était le seul moyen d’avancer face à une réalité à ce point tragique. « Je voulais un texte comme un message envoyé à Pluton, explique-t-il. Comme si j’allais expliquer la situation à une personne qui ne connaissait pas la différence entre une poule et un être humain. Cette logique sous-tend ce texte. » On n’oubliera pas que « l'être humain se distingue des autres animaux par son télé-encéphale hautement développé et son pouce préhenseur ». Une simple idée et non pas une idée simple face aux aberrations d'un système commercial mondialisant qui se prétend parfait et porteur de richesses. « L’Île aux Fleurs, c’est le chaos du monde filmé et classé par une sorte de facteur Cheval du documentaire qui […] brasserait un bric-à-brac de données platement objectives sur fond d’ironie et de lucidité pessimiste.»
MOI UN NOIR
JEAN ROUCH

France, 1959, Beta SP, couleur, 80’
Sa Bell & Howell 16mm à l’épaule, Jean Rouch filme le rude quotidien de trois jeunes Nigériens en quête de travail à Treichville, au sud de la Côte d'Ivoire. Il les suit chaque matin jusqu’au port où les trois garçons quêtent « une jobbine » pour la journée, Ce tournage léger, muet avec un enregistrement des voix en post-production lui permet de laisser ses acteurs improviser un commentaire après coup, sur les images. Une leçon que retiendront les cinéastes de la Nouvelle Vague. Avec ce film, le cinéaste transgresse d’autres frontières, à commencer par celle qui voudrait séparer le documentaire de la fiction. Il propose à ses jeunes héros de s’inventer chacun un personnage et compose avec eux une trame minimale. Ils seront donc «Edward G. Robinson», «Eddy Constantine, agent fédéral américain» et «Tarzan», déambulant dans les docks d’Abidjan et les boîtes de nuit de Treichville. En prenant des libertés avec les genres comme avec les formes, Jean Rouch accomplit là une petite révolution qui ne secoue pas seulement le cinéma ethnographique des années 50, En réalisant un cinéma au plus près de la vie, en sollicitant l’imaginaire de ses personnages, il poursuit son exploration ethnographique, et invente de nouvelles formes cinématographiques qui « universalisent » ses héros africains. Jean-Luc Godard écrit: «En résumé, en appelant son film Moi, un Noir, Jean Rouch qui est un Blanc comme Rimbaud, déclare, lui aussi que Je est un autre.» Moi, un Noir obtiendra en 1958 le prix Louis-Delluc qui récompense le meilleur film français de l’année.
MOSSO MOSSO
JEAN-ANDRE FIESCHI
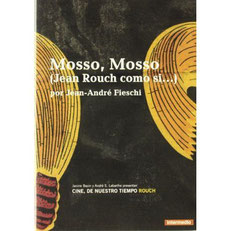
France, 1998, Beta SP, couleur, 73’
Pour réaliser ce portrait de Jean Rouch (destiné à la remarquable série télévisuelle Cinéma de notre temps) Jean-André Fieschi a suivi le cinéaste au Niger et au Mali. Comme si il s’agissait pour lui de tourner un film et qu’il s’appelait « La Vache merveilleuse ». Cette proposition, comme un jeu d’enfant, est la règle même du cinéma et de la vie de Jean Rouch. Une règle dans laquelle se glisse délicatement Jean-André Fieschi, pour mieux aller à la rencontre du cinéaste-ethnologue. « En faisant « comme si », explique Rouch, on est beaucoup plus proche de la réalité ». Et c’est ainsi que Jean-André Fieschi réussit à approcher la réalité de Jean Rouch, l’homme et sa façon de faire du cinéma C’est dans sa relation avec ses complices africains de toujours, Damouré et Tallou, que l’on découvre pleinement le cinéaste sur son terrain africain.
« Il semble, à survoler l'œuvre de Jean Rouch, des premiers courts métrages ethnologiques à ses derniers films, que ce qui en marque la nouveauté, la force de rupture, la tonicité réside surtout dans l'inconfort dont elle joue, faisant flèche de tout bois, usant de techniques diverses, mêlant des procédés jusqu'à elle antinomiques et ne se laissant enfermer dans aucune donnée acquise. » écrit Jean-André Fieschi.
NO LONDON TODAY
DELPHINE DELOGET
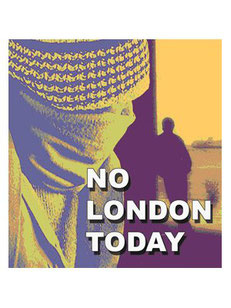
France, 2007, DVD, couleur, 77’
« No London Today ! C’est ce que m’a dit Arman la première fois où je l’ai rencontré, raconte Delphine Deloget. Nous étions tous les deux assis sur un banc. J’étais en vacances à Calais et lui attendait la nuit pour passer clandestinement en Angleterre. De là a commencé un drôle de voyage, dans un autre Calais sans plage ni terrasse. Un voyage immobile dans un port sans âme avec ses quais déserts et ses grues sans homme. De ce voyage, il me reste quelques instantanés… et des amitiés suspendues à ces nuits clandestines où, caché à l’arrière d’un camion, dans le ventre d’un ferry, dans l’obscurité d’un tunnel, chacun espère ne plus avoir à dire le matin "No London Today". »
Comme l’explique fort bien la cinéaste elle-même, No London today est un film qui n’hésite pas à montrer non seulement la situation de ces hommes, mais aussi la complexité de sa relation de femme-cinéaste-blanche à ces hommes. Cette relation est même le sujet du film. Sans pathos, sans s’arrêter à la compassion, elle tente de partager le « partageable » avec eux. Et c’est sans doute son humour, sa capacité à rire avec eux qui tisse ce terrain commun entre elle et eux. Elle crée avec eux un petit pont fragile et dangereux qui nous amènent, nous aussi, vers eux, vers leurs peurs, leurs espoirs, leur quotidien d’hommes clandestins.
Delphine Deloget est restée en contact avec ces hommes, et prévoit de filmer un deuxième volet sur l’installation des trois Erythréens en Angleterre.
NOTRE SIECLE
ARTAVAZD PELECHIAN

Arménie, 1982, DVD, N&B, 50’
« Toujours des processions, à la gloire de " notre siècle ", toujours cette impression d'une menace qui ne se dit pas, d'une rumeur qui se manifeste, mais ne s'incarne pas. Notre siècle, on ne l'oubliera pas, c'est le siècle des conquêtes et des génocides, le siècle de toutes les vanités aussi : les hommes vont y faire l'épreuve de toutes leurs prétentions. Ils lutteront contre les déterminismes de la nature, fabriqueront leur légende à coup de travestissements, de protocoles intimidants, d'audaces et d'entêtements, pour ne laisser en guise de témoignage que quelques images qui redisent, inlassablement, l'absurdité de cette vocation instinctive et totalitaire à la colonisation et à l'occupation des mondes. »
« Longue méditation sur la conquête de l'espace, les mises à feu qui ne vont nulle part, le rêve d'Icare encapsulé par les Russes et les Américains, le visage défait par l'apesanteur des cosmonautes accélérés, la catastrophe qui n'en finit pas de venir. » (Serge Daney, Libération, 11 août 1983).
Le film est dédié au 50ème anniversaire de la Révolution d'Octobre (1917).
NOUS
ARTAVAZD PELECHIAN

Arménie, 1969, DVD, N&B, 30’
Un montage alternant images d’archives et fabriquées, qui composent une lyrique inquiète, d'un humanisme vibrant, ou les regards succèdent aux visages, où le peuple arménien semble résister à toutes les blessures, à toutes les épreuves dont le quotidien rappelle symboliquement la teneur : dramatique avec un enterrement, comique et tragique à la fois, lorsque le conducteur d'un triporteur disparaît dans les gaz d'échappement du véhicule qui le précède, bouleversante lors de la séquence des retrouvailles, où hommes et femmes s'embrassent, s'enlacent, jusqu'au vertige. Sous le regard d'un visage d'enfant, visage primitif, visage douloureux dont la répétition souligne une volonté farouche de partage, de reconnaissance, et de paix universelle.
" Comment oublier ce peuple arménien en larmes dans les images d'archives des rapatriements successifs (de 1946 à 1950) : retour au pays, étreintes, retrouvailles, corps déportés par l'émotion et le montage qui, au sein de ces images, vrille comme un tourbillon, un vertige, une défaillance ? " (Serge Daney, Libération, 11 août 1983).
POUR UN SEUL DE MES DEUX YEUX
AVI MOGRABI
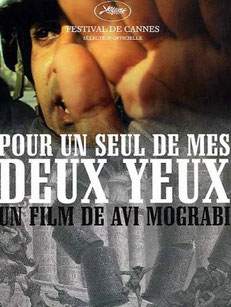
France-Israel, 2005, DVD, couleur, 100’
« Pour un seul de mes deux yeux », ce sont les dernières paroles de Samson dans la Bible, avant qu’il ne détruise les colonnes du temple qui s’écroulent sur lui en tuant ses ennemis, les Philistins. C’est là la première référence de ce quatrième film de Avi Mograbi. La seconde étant fournie dans la première séquence du film, évoquant l’épisode de Massada où des pères de famille zélotes tuent les leurs avant de se suicider pour ne pas tomber entre les mains des légions romaines. Ces mythes qui enseignent aux jeunes générations israëliennes que la mort est préférable à la domination, et que Avi Mograbi réinterroge ici à l’aune de la situation actuelle. Une situation de guerre ouverte entre Israëliens et Palestiniens, une situation absurde aussi, ici signifiée par les échanges téléphonique d’Avi avec un ami palestinien, coincé chez lui par le couvre-feu et les opérations de sécurité israéliennes. Comme toujours dans les films de Mograbi, il est là à l’écran, présent, actif. Son cinéma est un cinéma de parti-pris, dans le fond comme dans la forme. Et c’est par un hurlement de désespoir que le cinéaste achève ce film, celui qu’Avi Mograbi pousse lui-même quand il sort de derrière sa caméra pour protester face à des soldats israëliens qui bloquent arbitrairement des enfants palestiniens rentrant de l'école. Un cinéma étonnamment inventif, salutaire et courageux.
PUISQUE NOUS SOMMES NES
ANDREA SANTANA & JEAN-PIERRE DURET

Avant-première. France, 2008, Beta SP, couleur, 90’
Brésil. Nordeste. Une immense station service au milieu d’une terre brûlée traversée par une route sans fin. Cocada et Nego ont 13 et 14 ans. Le premier, orphelin, dort la nuit dans un camion et fait des petits boulots dans la journée. Le second vit dans une favela avec sa mère qui a eu 10 enfants et 9 maris. Les réalisateurs ont passé six mois à filmer dans ce paysage péri-urbain dévasté de quelques km2. Six mois à filmer, observer, écouter ces deux enfants dont le questionement existentiel ne nous est pas étranger. « Nego : - Tu sais qui tu es, Cocada ? – Cocada ! je suis ce que je suis ! – Il faut qu’on parte pour savoir qui l’on est ! »
« Ce film, expliquent les réalisateurs, n’est pas le portrait misérabiliste ou angélique de la pauvreté et de la violence d’un lieu défini. Il nous raconte une histoire universelle, celle de deux enfants qui cherchent à trouver leur place. Ils savent que là où ils sont nés, il n’y a pas d’avenir possible. Cette quête d’identité a pour décor le Brésil déshérité du Nordeste mais elle pourrait se situer partout dans le monde. Ce qui est surprenant et touchant avec Cocada et Nego, c’est l’énergie qu’ils mettent à échapper à leur destin. Comme nous, ils veulent savoir ce qu’ils sont et faire quelque chose de leur vie ».
SYMPHONIE PAYSANNE
HENRI STORCK

Belgique, 1944, Beta, N&B, 115’
Symphonie paysanne a été tourné pendant la seconde guerre mondiale. C'était avant l'incompréhension des paysans devant les directives européennes et leurs manifestations, avant l'impact écologiste, juste à un moment de défiance, celui de l'appel de Giono pour le retour à la terre. Cette configuration complètement étrangère à la profonde et constante générosité sociale d'Henri Storck n'a pas permis à ce film de prendre la place qui est la sienne. Celle d’un chef d’œuvre du cinéma. Ce film s'inscrit dans la trajectoire ethnologique d'Henri Storck. La mer, avec tout le cycle ostendais, la condition ouvrière, la condition paysanne, la captation des fêtes et carnavals, l'importance de l'art et des artistes; c'est une facette de ce cinéaste témoin de son temps. Le film est tourné sur quatre saisons. Il comprend également un cinquième volet, Les Noces paysannes qui est un peu la métaphore du déroulement du cycle, celui où l'homme prend à son compte le rapport ludique, amoureux et de constant travail qui règle le déroulement du monde. (Nous ne présentons à Corsica.Doc que les quatre saisons).
TABU
F.W MURNAU & ROBERT FLAHERTY

Etats-Unis, 1931, Beta, N&B, 90’
Tabu relate l’histoire d’amour interdite entre un jeune homme et une Maorie nommée Reri, une jeune fille déclarée tabou par sa tribu. "J'avais l'intuition que les tabous de ces îles pourraient constituer le thème de mon histoire. Un tabou n'est autre que ce que le mot tabou signifie : une interdiction jetée non point par les hommes, mais par quelque pouvoir divin. Autour de cette idée nous avions tressé avec Robert J. Flarhetly une intrigue aussi simple que possible. Je savais que nous pouvions en faire un film saisissant, si nous avions la chance de rencontrer des acteurs vraiment capables d'en vivre les événements.", expliquait F.W. Murnau. Et ce fut le cas : « Après, six mois de travail, ils avaient exécuté des scènes en tous points remarquables. »
Ce film marque évidemment un tournant dans l’œuvre de F.W. Murnau, essentiellement expressionniste. Place ici à la lumière, à la précision des contours et la densité des formes. Ce film, conçu en collaboration avec le documentariste Robert Flaherty, et terminé par Murnau seul est non seulement un film remarquable, il est aussi le fruit d’une sorte de « duel » entre deux cinéastes. Un duel que l’on pourrait réduire au conflit entre un cinéaste de fiction et un cinéaste de documentaire. Mais Tabu est là, à la fois poème lyrique et somptueux documentaire, comme une sorte d’œuvre symbolique qui scelle en un seul et même film, une union passionnelle entre deux formes de cinéma.
A.P.G.
UN DRAGON DANS LES EAUX PURES DU CAUCASE
NINO KIRTADZE

France, 2005, Beta SP, couleur, 90’
Un village du Caucase, au fond de la vallée de Borjomi, en Géorgie. Un 4x4 avance sur la route en terre qui grimpe parmi les maisons. Par la vitre baissée, un jeune homme tend aux villageois des documents qu’il leur demande de signer. Ce sont les propositions de rachat des terres sur lesquelles doit passer l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (1 760 km de l’Azerbaïdjan à la Turquie, dont 248 à travers la Géorgie). Les paysans de Sakiré accueillent le représentant de la compagnie pétrolière BP avec méfiance, voire hostilité. Il faut dire que, depuis que la construction de l’oléoduc a été annoncée, le village est en ébullition. Tout le monde espère en tirer profit. Tout le monde se méfie. Les rumeurs galopent, les jalousies s’exacerbent, la peur s’installe (peur d’un glissement de terrain, peur de la pollution…). Les habitants accusent le maire, qui n’en peut mais, d’avoir gonflé la liste des familles à indemniser. Le ton monte. Chacun commente, se lamente et s’enflamme…
Ce film, tourné en 2005, prend évidemment aujourd’hui une ampleur particulière dans l’actualité de la guerre déclenchée en août dernier entre la Russie et la Géorgie. Ce qui peut sembler là une comédie humaine hilarante digne d’un thriller, acquiert une dimension politique qui était sûrement présente à l’esprit de Nino Kirtadze. C’est là sa manière de faire, que l’on avait pu déceler dans Dites à mes amis que je suis mort. Mine de rien, Nino Kirtadzé est une cinéaste politique, au sens noble du terme. Derrière les engueulades, les palabres, la parodie de procès qui oppose BP au village, les excavatrices creusant les verts pâturages… Elle décrit avec un rare talent de dramaturge le combat perdu d’avance d’un petit village face à un gros dragon international. Dans cette bataille qui peut sembler minuscule, il y a les germes de conflits majeurs. Au niveau des Etats comme au niveau de la condition qui est faite aux hommes aujourd’hui. Sans doute est-ce là le film emblématique de la question qui sous-tend notre programmation, « le village et le monde ».
A.P.G.
UN PETIT MONASTERE EN TOSCANE
OTAR IOSSELIANI

Italie, 1988, Beta SP, couleur, 54’
Il y a vingt ans, Otar Iosseliani est parti filmer une petite communauté de moines augustins installée à Castelnuovo dell’abate, à côté de Montalcino, non loin de Sienne. Cinq moines, dont quatre jeunes hommes, vivant au milieu des paysans de cette région viticole. Pour Iosseliani, il ne s’agit pas d’effectuer un reportage sur la vie des moines, ni sur celle des villageois. Mais de déceler, dans la proximité de ces deux communautés, quelques échos de son questionnement morale. Une citation en exergue du film nous le signale: « Si nous voulons savoir de quelle valeur sont les biens de la Terre, considérons-les du lit de la mort : ces honneurs, ces divertissements, ces richesses nous serons enlevés un jour. Il faut conséquemment travailler à nous sanctifier et à nous enrichir des seuls liens qui nous suivent dans l'éternité ». (Saint Alphonse de Liguori). Dès lors, les scènes de la vie quotidienne austère des moines sont mises en regard avec celles où l’on voit des paysans aux prises avec les tracas « laïques » de l’alcool, du travail et de la solitude. Une façon de filmer à la Iosseliani, avec sensibilité et humour. Il ne s’agit visiblement pas de jouer les bons moines augustins contre les vilains paysans avinés. Il y a de la grâce dans les envolées de robes de bure au milieu des bistrots de Castelnuovo. Et de cette mise en regard toute simple, sans commentaire, surgit pour le spectateur un véritable questionnement existentiel.
Le film s’achève sur une promesse : « Ici se termine la première partie de ce film, la suite sera tournée dans une vingtaine d'années en ce même lieu et avec les mêmes personnages. » Otar Iosseliani y est effectivement retourné, mais il n’y a plus trouvé ce qu’il y cherchait. Le film n’aura pas de suite.
A.P.G.
VHS KAHLOUCHA
NEJIB BALKADHI

Tunisie, 2006, Beta SP, couleur, 80’
Peintre en bâtiment, Moncef Kahloucha est aussi et surtout cinéaste à ses heures. Un cinéaste du dimanche, dirait-on, mais pour lui, c’est tous les jours dimanche. Dans son quartier de Kazmet à Sousse, en Tunisie, il mobilise tous les voisins pour fabriquer ses films. Il en est le producteur, le réalisateur, le décorateur, le distributeur et l’acteur principal. Pour lui, comme pour n’importe lequel de nos jeunes cinéastes en devenir il s’agit de filmer à tous prix. Son univers cinématographique, c’est le film de genre des années 70. Aussi Nejib Balkadhi nous le fait découvrir dans une sorte de « making of » d’un tournage hallucinant dans les entrepôts du quartier. Le titre du dernier film de Kahloucha : Tarzan des Arabes. On suivra la gestation du film depuis le tournage jusqu’à sa projection dans un café du quartier et la circulation de la copie dvd chez les immigrés tunisiens en Italie. Bien sûr, ce film parle de l’amour du cinéma, de sa vertu utopique et onirique. Moncef Kahloucha se pose des questions de cinéma comme n’importe quel cinéaste. Kazmet est son Hollywood à lui. Mais ce n’est évidemment pas n’importe quel territoire et c’est l’autre grand intérêt de ce film que de débusquer derrière les décors et les figurants de Kahloucha, la condition des femmes, des jeunes de ces quartiers pauvres. Sans misérabilisme pour autant, il s’agit là du bonheur de jouer, de transfigurer le réel. Comme Kahloucha, tombant sa combinaison de peintre pour enfiler le slip léopard de Tarzan.
A.P.G.
LE VILLAGE DES FOUS
NINO KIRTADZE

Allemagne, 2007, Beta SP, couleur, 92’
À une centaine de kilomètres de Moscou, Mikhaïl Morozov, la cinquantaine bedonnante, règne en maître sur le village de Durakovo, littéralement "le village des fous" en russe. Y viennent ceux, souvent jeunes, qui souhaitent rompre avec la vie moderne et ses tentations, l'alcool ou la drogue, et aspirent à une discipline de fer. Si ce n'est le leur, tel est le souhait de leurs parents. Durakovo est un modèle de "démocratie dirigée", un concept en vogue dans la Russie de Vladimir Poutine. Homme d'affaires ayant fait fortune, Morozov, chrétien orthodoxe convaincu, a créé une microsociété placée sous l'autorité de Dieu, fonctionnant sur un modèle quasi féodal, hérité de l'époque des tsars. La réalisatrice éclaire avec vivacité l'un des visages de la Russie d'aujourd'hui, celui d'une fraction de la population, nostalgique d'un pouvoir fort, religieux et nationaliste. Ce laboratoire, modèle de rééducation pour l’installation de ce qu’ils appellent une "démocratie dirigée", reflète-t-il, à petite échelle, ce qui se prépare dans la Russie d’aujourd’hui ?
LES BRAVES (RAYMOND LEVY)
ALAIN CAVALIER

Avant-première. France, 2008, 41’, Beta SP, couleur.
Sous l’occupation allemande en France en 1944, Raymond Lévy, dix neuf ans, est arrêté pour faits de résistance. Avec d’autres déportés, il est mis dans un wagon de marchandises à destination d’un camp de concentration en Allemagne. Ils essaient de mettre au point ce qui parait impossible : s’évader de ce wagon avant le passage de la frontière. A plus de quatre vingt ans, Raymond Lévy raconte. Ce film est le premier opus d’une série démarrée avec ce documentaire et intitulée « Les Braves », pour laquelle Alain Cavalier a déjà réalisé deux films. L’aboutissement d’un long travail d’épure de son cinéma depuis les fictions à gros budgets tournées en pellicule jusqu’à ces documentaires tournées en solitaire avec sa petite caméra dv. "J'en suis arrivé peu à peu à ne filmer qu'au plus près de mon expérience", explique le « filmeur ». Pour Les Braves, c’est l’expérience des autres qu’il filme au plus près : « Les braves sont, pour moi, ceux qui refusent de se plier devant l'injustice, écrit-il. Je les filme de face, en un seul plan fixe, sans aucun document extérieur. Ils ne racontent que le moment précis où ils font preuve de courage pour rester eux-mêmes. La bravoure est partout, en guerre comme en paix. J'ai déjà filmé trois hommes qui n'ont pas eu froid aux yeux. Je souhaite en faire plus. Je les présenterais volontiers dans des lycées. »
LES SAISONS
ARTAVAZD PELECHIAN

Arménie, 1972, DVD, N&B, 30’
Peut-être l'un des plus beau films du cinéaste, c'est en tout cas celui qui lui assure aujourd'hui une reconnaissance internationale. Les Saisons est un très beau poème où sont évoqués, en une vaste parabole, les moments déterminants de l'histoire arménienne, depuis les origines volcaniques, jusqu'à la période industrielle. Mais au-delà de cette symbolique où l'on peut lire aussi l'histoire des migrations du peuple arménien, demeurent des séquences étonnantes et inoubliables : l'inertie lente et aventureuse d'une transhumance, des corps en apesanteur, comme passant, infiniment, par-dessus les terres, ou par-dessus les flots, méprisant tous les ancrages, une vision ludique, apaisée, de la moisson et de la fenaison, et ce rythme, surtout, ce rythme qui nourrit l'émotion, sans discours et sans commentaire, et qui fait de toute épreuve le témoignage d'un humanisme salutaire et sublime.
